Notre-Dame de Guadalupe
III. « La révélation de la beauté »
L'ANTIQUITÉ D'UNE TRADITION
Aux origines de l'histoire moderne du Mexique, brille « un phénomène religieux indéniable et clair comme la lumière du soleil, savoir les manifestations du culte à la Vierge du Tepeyac durant le XVIe siècle, non seulement par les masses indigènes mais également par les colons espagnols eux-mêmes » (Chauvet, op. cit. p. 17).
DES TÉMOIGNAGES IRRÉCUSABLES
De longues heures de recherche dans le trésor inestimable et encore peu étudié, même par les spécialistes, du Fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de Paris m'ont révélé la valeur incontestable des témoignages que récuse Lafaye, au sujet de ce culte et de son origine miraculeuse. (...) Je ne citerai donc ici que des documents inconnus de Jacques Lafaye.
Le Père Chauvet cite plusieurs témoignages qui attestent pour la toute première période, antérieure à « l'incident Bustamante » (1556), un culte général, officiel et notoire, en croissance continuelle, à cette Vierge qui passait pour faire des miracles. Selon Lafaye, l'incident Bustamante est le témoignage le plus ancien. Erreur profonde. Déjà vingt ans auparavant, le 15 novembre 1537, Bartolomé Lopez, habitant de Colima, ville récemment fondée par des colons de Mexico, inscrit dans son testament : « Je demande que l'on célèbre dans la Maison de Notre Dame de Guadalupe cent messes pour le repos de mon âme, que l'on prélèvera sur mes biens. »
UN CULTE CATHOLIQUE...
Le testament de Bartolomé Lopez infirme-t-il la thèse générale de J. Lafaye, selon laquelle, avant le dernier quart du XVIe siècle, le culte rendu à la Guadalupe de Mexico ne se distingue pas de celui que les conquistadores vouent à celle d'Estrémadure, côté espagnol, tandis que du côté indien, il se confond avec le culte de la déesse-mère Tonantzin ? À lui seul, il n'y suffirait pas. Mais je puis apporter un document, découvert dans le Fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de Paris, qui vient singulièrement appuyer le premier. C'est le Tanto del Testamento de don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin, le cacique de Teotihuacin : « La première chose que je mande est que, si Dieu me délivre de cette vie, tout de suite on donne quatre pesos d'aumône à Notre Dame de Guadalupe, pour que le prêtre qui réside dans cette église dise pour moi des messes. » Ce document est daté du 2 avril 1563, et il émane d'un indigène de pure souche qui pose un acte de religion proprement catholique : faire dire des messes pour le salut de son âme.
Ce testament est incontestablement authentique. Or, il est recoupé – ce qui est une fameuse trouvaille ! – par le récit, que rapporte le Nican Motecpana à la date de 1558, d'une rébellion à Teotihuacan qui échappa à une terrible répression par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe. L'auteur ajoute : « Aussi, à l'heure de sa mort, don Francisco se confia à la Dame du Ciel, notre délicieuse Mère de Guadalupe, pour quelle fasse grâce à son âme; et il fit un don en sa présence, selon qu'il apparaît dans les premières lignes de son testament qui a été fait le 2 mars 1563. »L'auteur du Nican Motecpana se trompe d'un mois, mais justement, l'erreur de date est une garantie d'indépendance des deux documents, qui confirme l'authenticité aussi bien de l'un que de l'autre.
... ET MEXICAIN
Non seulement cette « Vierge Brune » du Tepeyac est bien catholique – elle nourrit la dévotion des indigènes comme celle des Espagnols à la seule Vierge Marie, qui obtient grâce et salut à ceux qui l'en prient « à l'heure de notre mort »–mais encore elle est indépendante de celle d'Estrémadure. Un document le démontre, et l'argument est d'autant plus fort qu'il se tire des lois de ce que Lafaye appelle « la vie religieuse commerciale des sanctuaires chrétiens au XVIe siècle », lois qui n'ont jamais constitué, ne lui en déplaise, un aspect « inavouable » des affaires de dévotion. Ce côté « bruits d'argent autour de l'autel », a toujours été clairement reconnu dans l'Église et prudemment codifié. Or voici le fait. Maria Gomez présenta le 18 janvier 1539 une « lettre de paiement en tant qu'héritière de Juan de Iniesta (ou Iniestra), comportant, entre autres choses :
« Item : pour décharge du paiement fait à la Maison de Notre-Dame de Guadalupe ou à son procureur (je souligne) en son nom, de cent un pesos d'or des mines. Moyennant remise de lettre de paiement. »
Il se trouve qu'un moine du sanctuaire d'Estrémadure, Fray Diego de Santa Maria, envoyé au Mexique par son monastère peu avant la mission de Fray Diego de Ocana au Pérou, écrit à S. M. le roi d'Espagne qu'avant 1560 il n'y avait pas, en Nouvelle-Espagne, de procureur du monastère espagnol. Et l'on peut croire que, pour les raisons susdites, son enquête fut soigneusement faite ! « Par conséquent, conclut le P. Chauvet, le procureur dont il est question ci-dessus, ne peut être que le procureur de la Maison de Guadalupe du Tepeyac. »
UNE IMAGE « ORIGINALE »
La dévotion à la « Morenita de México » s'était donc répandue, dès 1537, au point d'atteindre une ville aussi éloignée que Colima ? Lafaye bâtit sa légende à lui : Cette Vierge Brune fut primitivement une copie de l'image « universelle » vénérée en Espagne. Nous avons vu l'incohérence interne de cette théorie. Elle se heurte de surcroît au précieux témoignage d'un catéchisme en images dont on conserve l'original à la Bibliothèque nationale de Madrid, Catecismo de la Doctrina cristiana de Fr. Pedro de Gante. Ce testeriano montre la Guadalupana mexicaine, dans l'Ave Maria, le Credo, les Articles de la foi, le Confiteor, etc., d'une facture extraordinairement naïve, toute proche encore des anciens codex. La Vierge du Tepeyac y est parfaitement reconnaissable - représentée de face, avec son manteau bleu et une robe rose - et bien différente de l'image conventionnelle qui illustre les catéchismes conservés à la Bibliothèque nationale de Paris, où la Vierge figure de profil et avec d'autres couleurs.
C'est donc cette Image, identique à notre Preciosa Imagen actuellement vénérée, que Fray Francisco de Bustamante dénonçait en 1556 comme une supercherie : « peinte par un indien ». Exactement comme l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcis, écrivait en 1389 au sujet du Saint Suaire, alors vénéré à Lirey, dans son diocèse, qu'il était l' « œuvre d'un peintre habile ». Voilà qui donne une merveilleuse consistance historique à la tradition « apparitionniste ». S'il n'y avait pas, sous-jacente, la croyance populaire à l'origine miraculeuse de la relique, on ne comprendrait pas la diatribe du provincial, pas plus que celle de l'évêque de Troyes, car toutes les autres images que nous vénérons, en Orient et en Occident, sont faites de main d'homme. Mais celle-là est non seulement tenue pour non faite de main d'homme, mais elle « passe », frauduleusement selon le prédicateur franciscain, pour « faire des miracles ». Abus intolérable !
L'INCIDENT BUSTAMANTE
Cette diatribe fit un scandale énorme, à preuve les dépositions des témoins à l'Information qu'ouvrit immédiatement l'archevêque. Fray Domingo Guadalupe Diaz, o.f.m., a raconté dans Historica comment il a retrouvé dans les archives de la cathédrale, le codex original dont le Père Chauvet publie l'édition critique en appendice à son ouvrage. L'ampleur de l'affaire, insoupçonnée à l'époque où Lafaye écrivait son livre, prouve à quel point cette dévotion était chère à toute une population : presque tous les témoins sont en faveur de l'archevêque, et contre le provincial.
Tout avait commencé par un sermon que monseigneur l'archevêque don Alonso de Montufar, dominicain, avait prêché en sa cathédrale le dimanche 6 septembre 1556, en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe du Tepeyac, sur la parole évangélique : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez » (Mt 13, 16). (...)
Deux jours plus tard, pour la Nativité de Notre-Dame, date où se célébrait la festivité principale de l' « ermitage » du Tepeyac, monseigneur l'archevêque s'y rendit en personne et expliqua aux néophytes, grâce au chapelain Francisco de Manjârrez qui servait d'interprète, « comment ils devaient comprendre la dévotion à l'image de Notre Dame, comment ils n'honoraient pas le tableau ni la peinture mais bien l'image de Notre-Dame, pour ce qu'elle représentait : la Vierge Marie, Notre-Dame ».
Mais au même moment les franciscains aussi célèbrent la fête de la Nativité de Notre-Dame dans leur grande chapelle Saint-Joseph des Indigènes. Il y a foule à la grand-messe, à laquelle assistent le président et les magistrats de la Real Audiencia. Maître Bustamante prononce un sermon « presque divin », aux dires d'un témoin, en l'honneur de la Vierge. Puis soudain son visage s'empreint d'une pâleur mortelle, et il lance qu'il n'est pas lui-même dévot de Notre-Dame, « parce qu'il lui semblait que la dévotion de cette ville envers un ermitage, Maison de Notre-Dame, dénommée de Guadalupe, était très préjudiciable aux indigènes puisque pareille chose faisait croire que cette image peinte par un Indien faisait des miracles et ainsi était dieu », après que, eux, les missionnaires avaient déployé tant d'efforts pour leur faire comprendre « que les images n'étaient que du bois et de la pierre, et qu'on ne devait pas les adorer (...) et que les Indiens étaient si dévots à NotreDame qu'ils l'adoraient. »
« De plus, on offensait Dieu Notre-Seigneur, selon les informations qu'il avait pu recueillir ; les aumônes qui étaient données auraient dû être destinées à des pauvres honteux qu'il y avait en ville. On ne savait pas cependant à quoi étaient destinées les aumônes et il aurait été bon de le savoir car cela n'allait pas au bénéfice des indigènes. Que le premier qui parlerait de miracles serait fouetté cent fois et celui qui le répéterait serait fouetté deux cents fois. Qu'il recommandait l'examen de ce genre de déclaration au vice-roi et à l'Audiencia, même contre l'aveu de l'archevêque, puisque le roi avait le pouvoir temporel et spirituel. »
Dès le lendemain 9 septembre, l'archevêque ouvre une information juridique contre le prédicateur. Des témoins furent entendus ; leurs dépositions sont d'un intérêt capital. Dans un édit antérieur, Fray Juan de Zumàrraga, le prédécesseur de Montûfar, s'était plaint de ce que, les dimanches et jours de fête, les habitants originaires de la ville préféraient qu'on leur dise la messe dans leurs propres maisons urbaines ou des environs de la ville plutôt que d'« aller à l'église avec les gens de basse extraction ». Selon Juan de Salazar, témoin à l'Information de 1556, les désordres déplorés par le premier archevêque prirent fin grâce aux visites, aux pèlerinages et affluences des foules au sanctuaire du Tepeyac : « Depuis qu'on a divulgué la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe (...)on ne s'entretient plus qu'en disant : “Où pourrions-nous aller ? Allons à Notre Dame de Guadalupe.” » Un autre témoin, Francisco de Salazar, « a vu des Espagnols aussi bien que des indigènes entrer à genoux dans le sanctuaire, avec une grande ferveur, depuis la porte jusqu'à l'autel où se trouve l'Image de Notre-Dame de Guadalupe ». Ce témoin ajoute que de petits enfants qui ont l'âge de raison, voyant leurs parents s'entretenir de cette dévotion, les importunent jusqu'à ce que ceux-ci consentent à les emmener à l'ermitage. Et il conclut : « Il apparaît que le soutien de cet ermitage et de cette dévotion sera pour le plus grand bien de tous, et faire le contraire serait ôter tout courage et, pour ainsi dire, la vie même à ce peuple. »
Il semble que le résultat le plus clair de l'incident fut d'imprimer un nouvel élan au pèlerinage. Un témoin achève sa déposition en déclarant : « Et dorénavant, si nous y allions une fois, nous irons maintenant quatre fois. » L'affaire ne fut pas menée à son terme, pour des raisons à élucider.
UNE CONSPIRATION DU SILENCE
Au fond, l'affaire se conclut un peu comme la querelle qui opposa l'évêque de Troyes à la famille de Charny, propriétaire du Saint Suaire au XIVe siècle. Dans son mémoire au pape d'Avignon Clément VII (1389), Pierre d'Arcis dénonçait le scandale qu'il y avait à laisser croire aux fidèles que le Suaire était le vrai Linceul du Christ, alors que « ledit linge avait été astucieusement peint ».Clément VII imposa silence aux deux parties, et permit que l'on continuât d'offrir le Suaire à la dévotion des fidèles, à condition qu'on leur expliquât bien qu'il ne s'agissait que d'une « représentation » et non pas du Linceul de Jésus-Christ lui-même.
Le résultat est qu'un brouillard épais enveloppe la manière dont le Saint Suaire est tombé en possession de la famille de Charny.
Il en va de même de l'ayate de Juan Diego. « Le silence des missionnaires résolus à se taire sur cette dévotion, ne pouvant ni l'interdire, ni la supprimer », fut peut-être imposé par le Conseil des Indes ou le Roi, conjecture le P. Chauvet. (...) Mais ni Fray Bernardino de Sahagun et, plus tard, Fray Juan de Torquemada, dans les années qui suivent l'esclandre de leur provincial, ne s'entendent sur l'origine de la dévotion et n'osent reprendre l'affirmation de leur provincial selon laquelle l'Image a été « peinte par un Indien », ni sa négation des miracles que cette Image faisait, et qui étaient alors de notoriété universelle. (...)
Le P. Chauvet, qui est un des meilleurs historiens contemporains de sa congrégation, en a fait l'objet d'un des chapitres les plus remarquables de son ouvrage. Sa fine analyse de la mentalité « prétridentine » des missionnaires évoque, irrésistiblement, une certaine mentalité postconciliaire lorsqu'elle s'en prend à des formes prétendument « exagérées » du culte populaire envers la Très Sainte Vierge en général et au Mexique en particulier. C'est lui-même qui fait le rapprochement, tellement il s'impose au vu des démêlés de Fray Maturino Gilberti, par exemple, avec les juges du Saint-Office, et c'est un trait de lumière. « Les théologiens post-tridentins du Saint-Office n'étaient pas d'accord avec certaines doctrines des missionnaires franciscains, relatives au culte des images et sur la base desquelles ils attaquaient le culte de la Guadalupana... Ainsi nous découvrons comment certaines attaques contre le culte guadalupano s'inspiraient de la théologie prétridentine du XVIe siècle que le Concile de Trente était justement en train de corriger. » (pp. 113-114) L'expérience quotidienne de notre actualité la plus brûlante nous fait soudain comprendre le drame qui se joua au Mexique, aux origines de son histoire moderne et catholique.
PASTORALE MISSIONNAIRE
D'abord il y a conflit de ce que nous appellerions, dans notre jargon moderne, les méthodes pastorales diverses des missionnaires. Les uns sont partisans des « méthodes intensives » et les autres des « méthodes extensives ». « Les premières se proposent de former de petits noyaux chrétiens initiaux sur la base d'une formation chrétienne préalable très intense (...). Les secondes préfèrent l'annonce rapide, massive et un peu superficielle de l'Évangile. Avec les premières on piétine, avec les secondes on a des chrétiens qui ne sont pas vraiment sortis de l'idolâtrie. En réalité, c'est la méthode extensive qui a prédominé au Nord Est au XVIe siècle. »(...)
Le résultat, précisément dans les années 1530, fut que certains Indiens après avoir été convertis et baptisés, prétendaient continuer leur culte idolâtrique en cachette. La vénération des images, chrétiennes et païennes mêlées sur les autels, s'y prêtait particulièrement. Souvent l'image chrétienne seule était bien visible et l'idole était cachée : Le Père Chauvet conclut : « On comprend qu'à la lumière de ces faits les frères franciscains comme les dominicains et augustins se soient sentis profondément préoccupés, et qu'ils aient vu avec méfiance et prévention certaines dévotions à des images et ermitages déterminés où les Indiens accouraient avec plus de ferveur et de fréquence que d'habitude. En conséquence, on prescrivit la norme pratique de ne fomenter ni favoriser le culte d'aucune image ni d'aucun sanctuaire particulier. » (86)
ÉRASMISME
À ces bonnes raisons pastorales, auxquelles se mêlait une certaine tendance à considérer les Indiens comme « immatures et un peu infantiles », il faut ajouter un autre préjugé, quasi théologique, qui avait cours surtout parmi les franciscains, sous l'influence d'Érasme : « Comme l'affirme Octavio Corvalan, l'érasmisme, en ce qui concerne l'Espagne, “fut une espèce de mode, irradiée par la cour de Charles-Quint” »(...).
L'érasmisme des franciscains espagnols est bien attesté au XIVe siècle, avec son idée-force d'une réforme nécessaire de l'Église, en vue d'un retour au pur Évangile et à l'Église primitive. (...)
Or, « Érasme distinguait deux genres de religion, l'intérieure et l'extérieure : la première est l'authentique la deuxième n'est, le plus souvent, que formalisme et apparence. En conséquence, il attaquait surtout le culte extérieur des saints, la vénération des images, et en général les cérémonies extérieures » (ibid. 91). Voilà toutes les arrière-pensées de Bustamante dans son retentissant sermon contre le Tepeyac ! C'est en vertu de ses présupposés érasmisants, que cet illustre provincial a accrédité auprès des chroniqueurs postérieurs la thèse d'une origine idolâtrique et donc satanique de ce culte. (...)
UNE CONVERSION RADICALE :
DU PANTHÉON AZTÈQUE AU CIEL CATHOLIQUE
Ni les franciscains du XVIe siècle, pour cause d'iconoclasme érasmien, ni Lafaye, pour cause d'évolutionnisme rationaliste n'ont voulu reconnaître la rupture de tradition totale que représente à cette époque et en ce lieu, de la part des Indiens, ce culte rendu à une telle Image. C'est tout le contraire du syncrétisme ! La vérité historique oblige à dire que nous touchons là, indiscutablement, la preuve de la conversion radicale de ces populations profondément idolâtres à un culte purement catholique et profondément marial. Cette incroyable rupture doublée d'une innovation subite, et durable, constitue une des énigmes les plus passionnantes de l'histoire du Nouveau Monde.
Lafaye ne pouvait pas voir cette évidence. C'est pour la fuir qu'il mentionne en passant les travaux de Jacques Soustelle, le maître incontesté d'une matière touffue et difficile, mais sans en citer une seule ligne. Car ce qui se passait là-bas avant permet de mesurer l'incroyable nouveauté de ce qui s'y pratiquera après.
INFESTATION DE SATAN
« La terre nourricière, la terre mère, aspect féminin de la dyade fondamentale des anciens Otomis par exemple (le “ Vieux Père ” –feu, la “ Vieille Mère ” – terre), bien qu'elle ait dû être vénérée dès une époque reculée, n'apparaît que tardivement dans l'art. Chez les aztèques, son rôle de protectrice des moissons est réservé à Chicomecoatl, “Sept-Serpent”, représentée le plus souvent avec des épis de mars dans les mains. C'est en tant que mère du grand dieu tribal Huitzilopochtli, donc en tant que mère du soleil, de la lune et des étoiles, quelle est adorée sous le nom de Coatlicue, Celle-qui-a-une-jupe-de serpent ou de Cihuacoatl, le Serpent-femme. »

Une statue de cette Tonantzin, « Mère-de-Dieu », particulièrement fameuse, est conservée au musée anthropologique de Mexico. Je demeurai saisi, en présence de ce monstre, d'un frisson d'horreur : sa tête est formée par le bizarre accouplement de deux têtes de serpent, sa jupe est un grouillement de serpents ; c'est vraiment l'expression formidable de cette obsession du serpent qui « semble avoir fasciné l'imagination indienne. Toute l'iconographie maya, celle de Teotihuacan, de Xochicalco, des Aztèques, regorge littéralement de représentations ophidiennes ». La statue de Coatlicue en est comme le flamboiement ultime à la veille de la conquête espagnole. Les premiers missionnaires franciscains y verront la marque d'une infestation de Satan. Cette théologie de l'histoire conçue comme une « lutte incessante entre les desseins salvateurs de la Providence et les tentatives perverses de l'Ennemi », recoupe singulièrement l'anthropologie positive moderne puisque « le motif du serpent à plumes se retrouve dans le temps depuis le début de notre ère jusqu'à la destruction des civilisations autochtones. » C'est moi qui souligne : voilà une coïncidence remarquable qui donne un fondement positif à l'idée des missionnaires du XVIe siècle, selon laquelle « l'histoire du passé ne pouvait être conçue autrement que comme un aspect et un moment de la lutte qui opposait depuis la résurrection de Jésus, Dieu et le diable. » (...)
COATLICUE LA MARÂTRE
Il suffit d'un effort d'imagination pour comprendre, compatir à l'angoisse, à l'immense et sombre tristesse qui constituaient le sentiment quotidien, insurmontable, profond d'un peuple écrasé sous l'oppression d'une religion qui, à mesure que l'on approche de la « catastrophe de 1521 », semble saisie d'une véritable frénésie homicide.
SACRIFICES HUMAINS

« Il est impossible de rien comprendre à la religion des anciens Mexicains, explique Soustelle, si l'on ne garde en mémoire que, pour eux, les sacrifices humains étaient indispensables à la bonne marche de l'univers. Le Soleil a besoin de nourriture, et cette nourriture, c'est le Chalchiuatl, “l'eau précieuse”, c'est-à-dire le sang humain (...). Le sacrifice sanglant, c'est l'alimentation (Tlazcaltiliztli) du soleil. Au centre du bas-relief du grand calendrier aztèque, on voit un visage qui tire la langue : c'est Tonatiuh, le soleil qui, altéré, exige son tribut de sang ».
Si l'on consent à considérer, cette inversion de la rédemption, par laquelle c'est le sang versé par l'homme qui sauve la vie du dieu, on comprend que « le sacrifice est un devoir sacré envers le soleil et une nécessité pour le bien même des hommes. Sans lui, la vie même de l'univers s'arrête. Toutes les fois qu'au sommet d'une pyramide un prêtre élève dans ses mains le cœur sanglant d'une victime et le dépose dans le quauhxicalli, la catastrophe qui menace à chaque instant le monde et l'humanité est encore une fois différée. Le sacrifice humain est une transmutation par laquelle on fait de la vie avec de la mort ».
C'est ainsi que le codex Telleriano-Remensis nous apprend qu'en 1487, à l'inauguration du grand teocalli de México-Tenochtitlán qui supportait les deux sanctuaires consacres à Tlaloc, le très ancien dieu de la pluie et de la végétation, et de Huitzilopochtli, l'empereur Auitzotl fit sacrifier vingt mille guerriers. (...)

Soustelle décrit sans émotion le rituel de ces sacrifices qui scandaient les dix-huit mois de l'année aztèque : « Dans la forme la plus courante de ce rite, la victime était étendue, le dos sur une pierre légèrement bombée, tandis que quatre prêtres lui tenaient les bras et les jambes, et qu'un cinquième, lui ouvrant la poitrine d'un coup de son couteau de silex, lui arrachait le cœur. Fréquemment, aussi, se déroulait le sacrifice que les chroniqueurs espagnols ont qualifié de gladiatorio attaché à un énorme disque de pierre, le temalacatl, par une corde qui lui laissait la liberté de ses mouvements, le captif, muni d'armes de bois, devait combattre successivement plusieurs guerriers aztèques normalement armés. Si, par extraordinaire, il ne succombait pas à leurs assauts, il pouvait avoir la vie sauve. La plupart du temps, le “gladiateur” s'effondrait grièvement blessé, et quelques instants plus tard expirait sur la pierre, la poitrine ouverte par les prêtres en robes noires, aux cheveux flottants. » Étrange association d'un sentiment religieux dépravé, qui n'est pas sans analogues dans l'histoire, avec les jeux du cirque ! Le célèbre jeu de paume qui se terminait par l'immolation du chef de l'équipe vaincue en est un autre exemple.

À vrai dire, ce sont les pires passions humaines qui se donnent libre cours sous ces fastes religieux : « À côté des déesses terrestres proprement dites, douées d'une grande variété d'attributs et de fonctions, il existait des divinités plus spécialisées, correspondant plus particulièrement à la végétation. Xochiquetzal, “fleur-plume précieuse”, était censée vivre dans les cieux supérieurs (...). Par maints caractères elle s'identifie à Tonacaciuatl, la déesse des naissances, “la vieille mère” du couple primordial ; elle domine, comme elle, le signe du jour, Xochitl (fleur), dans le calendrier divinatoire. On lui attribuait, comme à Tlazolteotl, l'invention du tissage et de la broderie, et elle présidait comme cette déesse à l'amour et au plaisir. Chez les Indiens de langue nahuatl de la vallée de Cuernavaca, on exhibait à l'occasion de sa fête des garçons de 9 à 10 ans et des fillettes ivres qui se livraient en public à toutes sortes d'actes érotiques. »Comme c'est touchant ! « Chez les Nahua de Tlaxcala, on lui sacrifiait les auianisme, courtisanes qui servaient de compagnes de plaisir aux guerriers célibataires. »
Il semble que « la pensée des Aztèques », comme disent avec un infini respect nos modernes ethnologues, soit demeurée entièrement stérile dans le domaine rationnel, expérimental et technique qui a fait le “miracle grec” : « Les civilisations précolombiennes n'étaient pas des “civilisations techniques ” », déclarait récemment Jacques Soutelle à la revue Évasions mexicaines 1980. « Sociétés souvent théocratiques, préoccupées en permanence des secrets métaphysiques, elles comptaient des astrologues, des astronomes, des mathématiciens, des écrivains, des poètes et des bâtisseurs. Mais, par contre, elles ignoraient la roue, la traction animale, la voûte et toutes les lois physiques démontrées par les Grecs, en un mot toute la science expérimentale. »

En revanche, quelles ressources d'invention dans l'art du crime sacré, réglé par une « théologie » supérieure ! « Le concept de la guerre cosmique qui domine la théologie aztèque ne lui était pas particulier, puisque tous les peuples nahuas, y compris les Toltèques, ont pratiqué les sacrifices humains au service des dieux astraux. Mais cette conception et les pratiques qui en découlent ont été portées au paroxysme à Tenochtitlán parce que les Aztèques étaient par excellence, pour employer l'expression d'Alfonso Caso, le “peuple du soleil”. Ils se considéraient expressément comme chargés d'une mission : celle de fournir au soleil la précieuse nourriture faute de laquelle il cesserait de reparaître à l'horizon oriental. » (...)
« Dans les cérémonies dédiées à Teteoinnan, on écorchait une femme et on découpait dans la peau de sa cuisse un masque destiné à la déesse. »
« Pendant le huitième mois de l'année aztèque, on sacrifiait dans le temple du dieu du mars une femme habillée et ornée de manière à représenter Xilonen, et durant la cérémonie on agitait une sonnaille, la “ sonnaille de brume ” qui appelle la pluie et la fertilité. »
« On décapitait, pendant quelles dansaient en feignant d'ignorer leur sort, les femmes vouées à la mort en l'honneur des déesses terrestres ; on noyait les enfants offerts au dieu des pluies Tlaloc; on jetait au bûcher, anesthésiées par le Yauhtli (haschich), les victimes du dieu du feu ; on perçait de flèches ceux qui, attachés à une sorte de chevalet, personnifiaient le dieu Xipe Totec : après quoi on les écorchait et les prêtres se revêtaient de leur peau. Dans la plupart des cas, la victime était habillée, peinte et ornée de manière à représenter le dieu auquel on rendait un culte. Ainsi, c'était le dieu lui-même qui périssait devant sa propre image et dans son propre temple, comme tous les dieux avaient accepté de périr dans les premiers temps pour le salut du monde. »Et lorsqu'une partie de la chair de la victime était mangée rituellement, « c'était la chair même du dieu que le fidèle absorbait dans une sanglante communion. »
UN PEUPLE ASSIS À L'OMBRE DE LA MORT
Il suffit de contempler la statuaire votive consacrée aux victimes de ces sacrifices au musée anthropologique de Mexico, pour le comprendre. L'expression d'angoisse qui émane de ces masques de pierre nous bouleverse encore, comme un appel du fond de l'abîme. Même Xochipilli, le dieu de la joie, de la musique et de la danse, porte le masque de cette effroyable tristesse (fig. ci-dessus).
Soustelle a lui-même avoué, un jour de vérité : « On peut se demander où cela d'ailleurs les aurait conduits si les Espagnols n'étaient pas arrivés... L'hécatombe était telle quelle aurait fini par menacer l'équilibre démographique, et qu'ils auraient dû sans doute cesser l'holocauste pour ne pas disparaître. »
Ce sont là les antécédents véritables, soigneusement cachés par Lafaye, du culte si pur rendu à Sainte Marie de Guadalupe, « Notre Mère », depuis quatre cent cinquante ans. Dès lors, comment expliquer le passage de ce monde de sang et de mort à cet autre tout radieux de pure lumière, de vérité et de vie ?
Il suffit de contempler les deux « Tonantzin », Coatlicue et Sainte Marie de Guadalupe, pour mesurer l'abîme qui les sépare. (...)
Les anciens Mexicains voyaient, avant tout, la première « recueillant le sang et le cœur des victimes que l'on sacrifiait “à notre mère et notre père, la terre et le soleil”, et absorbant les dépouilles de tous les morts », dans une escalade de l'horreur, « idiosyncrasie, frénésie de sacrifices proche de la panique pour sauver de l'abîme le quatrième et dernier soleil dont la disparition provoquerait la fin de l'univers. » Cette « vision religieuse » était imposée méthodiquement à un peuple soumis par des tlatoanis tout-puissants, sous le regard d'idoles hideuses qui restaient... de pierre. Or voici que ce génocide sacré se trouve brusquement interrompu par un culte nouveau. Celui-là ne s'ajoute pas aux autres, contrairement à la tendance traditionnelle de la religiosité aztèque au syncrétisme. Il les chasse tous, définitivement, souverainement... Mais en même temps qu'elle guérit les Indiens de l'idolâtrie, elle se dresse en insurmontable obstacle à la nouvelle pastorale iconoclaste des missionnaires franciscains, ses fils malavisés. Elle triomphe des idoles par son Image et, d'avance, de l'hérésie menaçante.
LA RÉVÉLATION DE LA BEAUTÉ

La rupture culturelle est telle qu'il n'y a pas d'explication historique cohérente en dehors de ce qu'atteste la tradition indigène et créole : la Vierge Notre-Dame est apparue en 1531 à un Indien, Juan Diego, et lui a donné pour gage de la véracité de ses apparitions son Image imprimée sur sa tilma.
Voici que la seule apparition de cette Image merveilleuse, véritable révélation de la Beauté de Dieu empreinte sur son visage, apporte à un peuple « sans affection » (Rm 1, 31) la révélation de son Amour miséricordieux.
« UN SIGNE GRANDIOSE DANS LE CIEL » (Ap XII).
Cette image est celle de la Vierge Marie et elle réunit tous les éléments symboliques de la Femme apparue à Jean, dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre XII. (...) L'exégèse la plus moderne identifie la Femme de l'Apocalypse à la Vierge Marie, parce que « les liens les plus profonds rattachent Jean XIX, 26-27 à la Femme qui enfante dans les douleurs d'Apoc. XII. Même s'il est vrai que, dans cette dernière péricope, c'est principalement le peuple de Dieu qui est visé, il nous apparaît maintenant presque impossible que l'auteur n'ait pas en même temps songé à la Vierge Marie, puisque le quatrième évangile atteste que Jean, déjà à Cana, et surtout au Calvaire, a contemplé en Marie la Femme dont les oracles prophétiques avaient annoncé l'enfantement merveilleux, la Sion idéale des temps eschatologiques ».
En revanche, n'en déplaise à Lafaye, « il s'en faut que cette interprétation mariale du chapitre soit unanime, tant chez les auteurs anciens que parmi les exégètes contemporains ». On peut même dire que « la majorité des Pères, tant en Orient qu'en Occident, semble avoir été en faveur de l'interprétation collective, et non mariale d'Apocalypse XII ».
Il a donc fallu à Miguel Sánchez une bien puissante raison pour opérer cette audacieuse assimilation, et cette raison impérative n'est autre que l'Image du Tepeyac. C'est elle qui fait le lien parce qu'elle est tenue par le bachelier, en vertu d'une antique tradition, pour la véritable et fidèle Image de la Vierge apparue à Juan Diego. Or, elle évoque puissamment la vision décrite par Jean l'Évangéliste : « Un signe grandiose apparut au ciel : c'est une Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. » On notera pourtant qu'elle n'est pas à proprement parler revêtue du soleil, on dirait plutôt qu'elle l'éclipse. Elle n'est pas non plus couronnée de douze étoiles, mais quarante-six étoiles brillent sur son manteau. Elle est enceinte mais ne crie pas dans les douleurs. De telles différences dans la ressemblance sont sans doute d'une haute et mystérieuse signification. Elles nous permettent pour le moment d'affirmer que l'image du Tepeyac n'a pas été peinte sur le modèle de la vision de l'Apocalypse.
UN CODEX INDIGÈNE
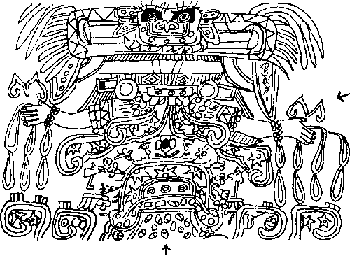
« La Vierge de Guadalupe, avatar moderne de la Tonantzin aztèque de Tepeyacac, déesse à la fois terrestre et lunaire », déclare péremptoirement Soustelle. Et voilà comment se propagent les canulars dans les milieux savants de la capitale ! Je suis même sûr que Soustelle n'a jamais regardé attentivement la Vierge de Guadalupe. S'il l'avait fait, lui, il aurait remarqué qu'elle constitue un véritable glyphe sacré, une représentation en image de l'ensemble du mystère chrétien, qui prend le contre-pied méthodique de tout le symbolisme de Coatlicue. (...)
Nous demandons seulement à M. Soustelle : Comment se fait-il que le dernier avatar de cette conception de l'univers prenne le contre-pied de tous et chacun de ses éléments traditionnels ? Et qu'il les supplante d'un seul coup, en quelques années, sans violence, mais par la seule force d'une « accumulation de puissance sacrale » (Lafaye, p. 366) dont le charme irrésistible opère encore sur soixante millions de Mexicains, quatre cent cinquante ans après ?
IMMACULÉE CONCEPTION
En effet, cette Femme semble mettre fin à l'antique lutte astrale, puisque le soleil l'environne, les étoiles ornent son voile et la lune la soutient en une parfaite harmonie cosmique.
D'abord, elle est entourée de nuages et semble ainsi régner sur les pluies dispensées jadis par le redoutable Tlaloc : « Pour les agriculteurs du centre, tout dépendait de la régularité et de l'abondance des pluies ; aujourd'hui encore, le début de la saison des pluies est attendu avec anxiété par des milliers et des milliers de Mexicains. » C'est pourquoi la crainte qu'il inspirait était si grande, « puisqu'il pouvait condamner le peuple à la famine en refusant la pluie, qu'on avait le sentiment de lui devoir toujours quelque chose, de ne jamais faire assez pour lui (...). Pour satisfaire ce dieu jaloux, on lui offrait comme victimes des enfants (...). On les conduisait en barque, sur la lagune, jusqu'à un tourbillon, où on les précipitait et qui les engloutissait » (128).
La Vierge Marie, elle, sans rien demander d'autre que la prière – à « tous ceux qui, pleins d'amour pour moi, crieront vers moi et mettront leur confiance en moi »,apporte déjà tous les biens du paradis terrestre de Tlaloc. Les arabesques d'or de sa tunique rose dessinent des fleurs identiques à celles qui décorent la fresque de Teotihuacan où l'on voit ce dieu affairé à préparer son paradis, le Tlalocan. Elle donne d'ailleurs elle-même l'exemple de la prière par ses mains jointes sur sa poitrine en une attitude de douce et confiante demande, indiquant par là qu'elle n'est pas elle-même une déesse, mais que, grâce à sa position élevée de Mère du Dieu qu'elle porte en son sein, son pouvoir d'intercession auprès de Lui ne peut être égalé par aucune créature.
MÈRE DE DIEU

La ceinture, remontée par le ventre gonflé, retombe en deux pans, sous les mains jointes, au-dessus de la fleur solaire qui se détache au milieu des arabesques d'or décorant la tunique rose.
Car elle est enceinte. Ce détail important suffit à faire de cette dévotion le culte le plus pur de la religion mexicaine, le plus christocentrique, le plus éloigné de toute « mariolâtrie ». Au centre de sa basílica, elle est le tabernacle du Très-Haut, et en se prosternant à ses pieds, ce n'est pas elle qu'adorent ses dévots, c'est l'Enfant qu'elle porte en son sein.
Pour que nul n'en ignore, elle montre, remontée par le ventre gonflé, la ceinture à double pan qui désigne dans la statuaire votive aztèque les Ciuateteo, les « femmes divines », mortes en couches, assimilées aux guerriers tombés au combat ou sacrifiés. « Divinisées, elles hantaient le ciel de l'Ouest et les ombres du crépuscule. On les identifiait plus ou moins clairement avec les Tzitzimime, monstres de l'au-delà qui doivent apparaître au dernier jour du monde, et d'autre part aux déesses mères sous leur aspect guerrier et macabre. Leur apparition ou les cris lugubres qu'on les entendait pousser dans le ciel du couchant étaient considérés comme des présages funestes. »
Ici, son apparition, « du côté où le soleil se lève », est source de vie. Elle apporte le soleil, elle est elle-même toute transfigurée par ce fardeau dont elle irradie les rayons d'or. Sur le ventre virginal, à l'emplacement même de l'Enfant, se détache une fleur à quatre pétales, symbole de la « Fleur solaire ».
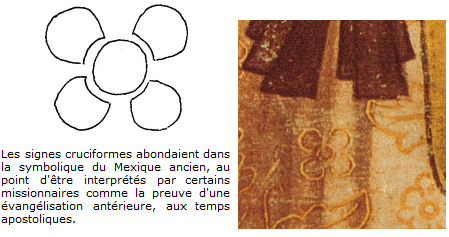
C'était le plus familier des hiéroglyphes nahuatl. Il se composait toujours de quatre points unifiés par un centre, en quinconce. Le cinq est le chiffre du centre et celui-ci est le point de contact du ciel et de la terre. « Le milieu, c'est le point de contact des quatre espaces, de notre monde et de l'au-delà, le carrefour par excellence (...). Le monde est construit sur une croix, sur la croisée des chemins qui conduisent de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud »,explique Soustelle.
Le cinq désigne aussi la pierre précieuse qui symbolise le coeur, lieu de rencontre des principes opposés. C'est le « soleil d'aujourd'hui, le cinquième, c'est le soleil du centre ; la divinité du centre est Xiuhtecutli, dieu du feu : aussi notre soleil est-il un soleil de feu représenté parfois par le même symbole que le feu, un papillon ». Tel est le glyphe extraordinairement impressionnant, sur le ventre de cette parturiante, qui l'identifie à la Vierge-Mère de Dieu, Arche de l'Alliance nouvelle et éternelle.
CORÉDEMPTRICE
Or, « tout le cinquième soleil sera dominé par ce grand thème de la mort et de la renaissance, du sacrifice nécessaire à la vie des astres et de l'univers » (96-97).
Notre céleste vision répond aussi à cette hantise, car elle porte en pendentif une autre croix, signe d'un sacrifice rédempteur qui abolit les inutiles sacrifices du temps passé, et qui apporte la renaissance attendue à Elle d'abord, mais aussi à tout un peuple régénéré.

Les Nahuas se faisaient de l'au-delà une idée complexe : « Si les ténèbres de Mictlan engloutissaient la foule anonyme des morts ordinaires, une immortalité céleste attendait les guerriers, une immortalité terrestre était promise aux élus du vieux dieu agraire. » (80) En effet, « pour les Aztèques, les guerriers morts au combat ou sur la pierre des sacrifices demeuraient les compagnons du Soleil. Ils se joignaient au cortège éblouissant, bruyant et joyeux qui entourait l'astre depuis l'Orient jusqu'au zénith ». C'étaient les Quauhteca, “ gens de l'Aigle” ; « Quauhtli, aigle, désigne également, dans le langage ésotérique des prêtres, le soleil et les guerriers. Le soleil est le dieu des guerriers qui le nourrissent du sang de leurs victimes. La plume d'aigle est le symbole de la guerre et des sacrifices humains », comme de la survie promise aux victimes qui entraient dans le cortège triomphant du soleil (88).
Cette Femme qui semble monter dans le Ciel, domine de toute sa taille surhumaine non seulement les éléments du cosmos mais aussi un être dont l'expression souffrante a quelque chose de tragique ; il paraît bien évoquer la condition terrestre. D'ailleurs, il est placé sous la lune et à l'extérieur du nimbe solaire où elle habite. Mais ses ailes d'aigle annoncent sa survie bienheureuse par la vertu du mystère de mort et de résurrection, du sacrifice rédempteur, figuré par la croix que lui aussi porte en pendentif. Ainsi est-elle aussi la mère de cet homme aux traits enfantins qui semble lui faire cortège en soutenant d'un geste gracieux la traîne de son voile et le pan de sa robe.
TRÔNE DE LA SAGESSE
 « Elle n'est plus couronnée d'étoiles mais elle le fut au moins jusqu'au XIXe siècle », affirme sentencieusement Lafaye. Première nouvelle ! On voudrait connaître les références d'une si grave affirmation, aussitôt démentie d'ailleurs par la suite « et ses nombreuses répliques mexicaines anciennes sont couronnées ». Oui, mais pas d'étoiles, justement ! En réalité, les étoiles ne sont pas sur sa tête en couronne mais distribuées partout sur son voile; et non pas au nombre de douze, mais de quarante-six. Elles y « fourmillent », comme à Pontmain où elles quittèrent leur place au firmament pour venir se plaquer sur sa robe. Ici de même, elles jettent leur éclat d'or sur le fond de ce voile couleur quetzal, du nom de l'oiseau aux longues plumes vertes, « l'oiseau précieux par excellence pour tous les Indiens du Mexique. » Ces plumes servaient à fabriquer le penace, diadème du Tlatoani (fig. ci-dessus), grand prêtre ou empereur, porte-parole de la divinité.
« Elle n'est plus couronnée d'étoiles mais elle le fut au moins jusqu'au XIXe siècle », affirme sentencieusement Lafaye. Première nouvelle ! On voudrait connaître les références d'une si grave affirmation, aussitôt démentie d'ailleurs par la suite « et ses nombreuses répliques mexicaines anciennes sont couronnées ». Oui, mais pas d'étoiles, justement ! En réalité, les étoiles ne sont pas sur sa tête en couronne mais distribuées partout sur son voile; et non pas au nombre de douze, mais de quarante-six. Elles y « fourmillent », comme à Pontmain où elles quittèrent leur place au firmament pour venir se plaquer sur sa robe. Ici de même, elles jettent leur éclat d'or sur le fond de ce voile couleur quetzal, du nom de l'oiseau aux longues plumes vertes, « l'oiseau précieux par excellence pour tous les Indiens du Mexique. » Ces plumes servaient à fabriquer le penace, diadème du Tlatoani (fig. ci-dessus), grand prêtre ou empereur, porte-parole de la divinité.
Ce serait ici le lieu d'expliquer, de raconter« la gloire de celui qui fut tout à la fois un prêtre, un roi, un dieu : Quetzalcóatl, le serpent revêtu des plumes vertes et dorées du quetzal ». Tâche difficile, car « pour nous qui cherchons dans les vestiges laissés par les hommes d'autrefois, le sens de leurs profondes pensées, l'histoire et le mythe du Serpent à plumes se voilent de contradictions et d'obscurités qui augmentent à mesure que croît notre connaissance » (12).
« Prêtre pendant son apparition sur la terre », il demeure le modèle des deux grands prêtres de Mexico, appelés tous deux « serpents à plumes ». « C'est à lui qu'on se réfère comme au type accompli de la sagesse religieuse. Roi, il fut le souverain des Toltèques. Dans sa cité de Tula aux édifices de rêve faits de métaux précieux, de coquillages éclatants et de plumes multicolores, l'abondance et le luxe s'épanouissaient autour de lui (...). L'époque fabuleuse où Quetzalcóatl avait régné sur Tula, c'était l'âge d'or de la civilisation. Or, toutes les traditions concordent sur ce point : Quetzalcóatl, grand-prêtre et roi de Tula, n'a jamais accepté les sacrifices humains. Il offrait aux dieux son propre sang et celui des oiseaux, mais jamais il ne tua un homme devant les autels. C'est même de là que vint sa chute (...). Des sorciers étrangers –à leur tête Titlacauan-Tezcatlipoca, le dieu du ciel nocturne et de la Grande Ourse, des enchantements et des ténèbres –arrivèrent à Tula, et leur magie noire fut victorieuse du roi-prêtre qui refusait de tuer des hommes en offrande aux divinités. Comprenant que le temps du déclin était venu pour lui, Quetzalcóatl se sépara en pleurant de son peuple (...). Deux traditions distinctes décrivent son ultime départ : selon l'une, il dressa au bord de l'océan un bûcher sur lequel il monta, et l'on vit son cœur sortir des flammes sous la forme d'une étoile lumineuse. »
En cette Femme revêtue de toute la sagesse royale et religieuse, voici le retour de l'Étoile du matin, que promettait aussi le mythe toltèque. Elle pose un pied victorieux sur la puissance maléfique de la nuit, ce croissant de lune tout noir, à qui on sacrifiait chaque année au mois Toxcatl un jeune homme qui avait vécu pendant un an comme un seigneur.
UN NOM INEXPLICABLE : SAINTE MARIE DE GUADALUPE
Cette Image bénie parle donc un langage familier à la mentalité nahua, en contredisant ses affreux mythes religieux, en ramenant à elle tous les articles de sa conception de l'univers. Une chose demeure cependant inexplicable, profondément étrangère à cet univers même : son nom, imprononçable d'ailleurs au gosier aztèque – rebelle aux D et aux G. En revanche, nous le savons extrêmement familier aux Espagnols. Il appartient à leur langue, à leur univers, à leur patrimoine religieux et national essentiel. « On a pu écrire que “Guadalupe est l'histoire d'Espagne depuis la bataille de Salado jusqu'à l'édification de l'Escorial” c'est-à-dire de 1340 à 1561. »
On pourrait tout aussi légitimement écrire de la Vierge du Tepeyac qu'elle « est » l'histoire du Mexique, depuis 1531 jusqu'à nos jours. Et j'écris à dessein que son nom, Guadalupe, va à la rencontre de la dévotion extremeña (d'Estrémadure), parce qu'elle n'en provient pas. La filiation de l'une à l'autre est impossible à établir, nous l'avons constaté ; les extravagantes imaginations de J. Lafaye ne peuvent rien contre ce fait historique.
C'est au point que selon certains auteurs, « Guadalupe » n'est que la corruption d'un mot nahuatl que les Espagnols n'arrivaient pas à prononcer. Pour les uns : Te-cua-tla-xopeuh, « celle-qui-est-apparue-au-sommet-des-rochers » ; ou Te-quau-tlaxopeuh, « celle-qui-a-fait-fuir-ceux-qui-nous-mangeaient » ; selon d'autres : Te-coa-tla-xopeuh ; « celle-qui-écrasera-le-serpent-de-pierre ». Comme les Espagnols ne pouvaient prononcer ces mots-là, ils les déformèrent jusqu'à les convertir en « de Guadalupe », selon un processus attesté pour de nombreux noms géographiques nahoas. Mais, justement, ici les documents font entièrement défaut. « Jusqu'à présent, écrit le Père Chauvet, je n'ai pas rencontré un seul document qui témoignât de la transformation. » (201)
D'ailleurs, mis à part certains glissements de noms bien attestés, une tradition indigène tenace prévaut, selon laquelle « les indigènes tiennent beaucoup à conserver les anciens noms de leurs localités. Au XVIe siècle, si on demandait à un indigène s'il allait à Puebla, il répondait : Oui, je vais à Cuitlaxcoapan, ou, à Cuitlaxcohauapan, nom nahoa de la localité où a été fondée Puebla de Los Angeles en 1531 ». En revanche, les codex historiques indiens nous apprennent que, jusqu'au milieu du XVIe siècle, « les indigènes n'utilisaient pas communément le nom de Guadalupe pour désigner le sanctuaire du Tepeyac, mais ce dernier nom et surtout celui de Tonantzin, qui déplaisait si fort à notre insigne P. Sahagun à cause de l'ambiguïté qu'il lui prêtait. Selon le P. Fr. Martín de Léon, o.p., en 1610 on disait encore “Je vais à Tonantzin” » (203).
Et pourtant ! L'« incident Bustamante » a révélé que déjà en 1556 les missionnaires franciscains déploraient que les gens appellent la Vierge du Tepeyac « Guadalupe ». (...)
Ce qui est certain, c'est qu'il y eut, un changement dans les années 1560, à partir desquelles le nom de Guadalupe s'impose pour désigner le Tepeyac. Et non pas l'ermitage, qui était déjà ainsi nommé, mais le village qui prend le nom de l'ermitage. Nous sommes aux origines de ce que l'on nomme aujourd'hui la Villa de Guadalupe. Tandis que l'ermitage portait ce nom depuis les années 1530, comme l'attestent les fondations de messes que nous avons citées.
Alors ? Tout bien considéré, on est conduit à conclure que le nom de Guadalupe a été donné à ce pèlerinage « parce que telle fut la volonté de la Vierge apparue ». Ce n'est pas parce que cette volonté ne se déclare qu'à la fin du récit qu'il faut en soupçonner l'authenticité. Au contraire, c'est en cet endroit qu'elle joue son rôle, décisif, pour emporter la conviction de Juan de Zumárraga. L'épisode fait corps avec tout le reste du récit et le termine.
LE PROCÉDÉ DE LA SAINTE VIERGE
Becerra Tanco écrit : « Le motif pour lequel la Vierge a voulu que son Image s'appelât “Guadalupe”, elle ne l'a pas dit ; ainsi reste-t-il ignoré jusqu'à ce que Dieu daigne éclaircir ce mystère. » Eh bien, à nous, depuis Lourdes, il a été donné de comprendre ce que nous appellerions volontiers « le procédé de Marie ». Par ce nom, la Vierge Notre-Dame a fait signe aux Espagnols incrédules, qui ne pouvaient concevoir qu'elle apparût à un Indien, et un Indien de la dernière catégorie : un macehualli. N'a-t-elle pas procédé de même avec l'abbé Peyramale ? Qué soy éra Immaculade Councepciou, répond-elle à Bernadette qui lui demande son nom de la part de Monsieur le Curé. La voyante ne comprend pas ce vocable, ces mots mystérieux. Elle les répète pour ne pas les oublier en courant vers le presbytère. « Ce que les deux mots, Immaculade Councepciou, signifient, elle n'en a pas l'idée. Mais l'Apparition ayant commencé par Qué soy, il est évident qu'elle s'est nommée... En voyant entrer Bernadette, l'abbé Peyramale lui dit : “ Que veux-tu aujourd'hui ? ” Mais, sans dire bonjour ni bonsoir, elle répétait :
« Qué soy éra Immaculade Councepciou. »
– Que dis-tu, petite orgueilleuse ? s'écria M. le Curé.
« Qué soy éra Immaculade Councepciou... »
Alors, elle se ravisa :
« C'est la Dame qui vient de me dire ces paroles ».
« J'en ai été tellement bouleversé que je me suis senti chanceler et sur le point de tomber », devait confier l'abbé Peyramale. « En lui, le théologien a sursauté en frôlant le surnaturel. Ces termes, que le prêtre reprochait à l'ignorante écolière de répéter inintelligemment, et donc quelle n'a pas pu trouver toute seule, qui les lui a soufflés ? Ils désignent, sans erreur possible, la Vierge Marie dans le premier de ses privilèges. En ce cas, la Dame ceinte d'azur serait une réalité ? (...). On ment avec des mots que l'on connaît, mais non avec des mots dont on ignore le sens. » Or, non seulement Bernadette ne sait pas ce que veut dire Immaculade Councepciou mais « elle n'arrivait pas à prononcer correctement le dernier mot ».
De même, Guadalupe,que prononçait avec peine Juan Bernardino, constituait pour Zumárraga une signature sans équivoque de Sainte Marie. Ce nom, Juan Bernardino ne pouvait pas l'avoir inventé, aucun indigène ne l'aurait inventé. C'est pourquoi ils mirent si longtemps à s'y habituer. Ils disaient « Sainte Marie Tecualallope » encore au milieu du XVIIe siècle, raconte Becerra Tanco (Chauvet, p.102), et encore plus souvent, Totlazonantzin, notre précieuse, charmante, jolie Mère.
Mais les Indiens cultivés, tel Valeriano, qui connaissaient trois langues : nahuatl, espagnol, latin n'eurent pas de difficulté à adopter ce nom que nous trouvons en toutes lettres dans le Nican Mopohua. Il manifeste aux conquérants espagnols que la Vierge Marie, leur Reine à eux, est aussi la Mère pleine de Miséricorde des Indiens qu'il leur faut convertir et aimer comme des frères en Jésus-Christ.