Les œuvres sociales de Mgr Freppel
« L’ouvrier ne vit pas de jeux et de délassements. Il vit de son travail journalier. Son travail, c’est son gagne-pain, il est sa grande préoccupation de chaque jour, il y attache ses espérances d’avenir, son honneur et son âme. Celui-là donc rendra à l’ouvrier le véritable service dont il a besoin et, dès lors, gagnera son cœur, deviendra son ami, qui s’intéressera à son travail pour le protéger. Ce qu’il lui faut, s’il est ouvrier, c’est du travail bien rémunéré dans un milieu chrétien, et, s’il est patron, commerçant, c’est de la clientèle et du crédit.
« Cette question d’un emploi qui est le gagne-pain quotidien, ou celle de la clientèle ou du crédit, sans lesquels à bref délai c’est la ruine, la faillite, le déshonneur, voilà les questions angoissantes. »
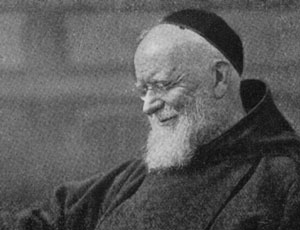
Pour y répondre, le Père Ludovic fonde, en mars 1875, la Société protectrice du travail et de la vertu, un bureau de placement – nous dirions aujourd’hui une agence pour l’emploi – pour les jeunes filles obligées de travailler dans les ateliers. Puis, cette société s’organise pour veiller sur l’apprentissage des plus jeunes. Une caisse de secours mutuels s’ouvre ensuite grâce à laquelle l’ouvrière malade recevra une indemnité durant le temps de sa maladie, les soins du médecin et les médicaments gratuits et, si nécessaire, la présence d’une “ veilleuse ” de nuit. Le 14 avril 1876, la société reçut l’approbation préfectorale lui donnant ainsi une existence légale nécessaire à son extension. Elle ne devait s’éteindre que dans les années 1900 avec les persécutions religieuses.
Malgré les incompréhensions et les calomnies prodiguées par certains représentants angevins de l’œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers, Mgr Freppel ne cessa de soutenir le Père Ludovic de toute son influence et de toute son autorité. Celui-ci publia un annuaire des patrons, entreprises, commerces, artisans et ouvriers ouvertement catholiques. Ainsi pensait-il reconstituer peu à peu les corporations d’autrefois. Approuvant son œuvre, Mgr Freppel lui écrivait :

« Il est temps de montrer aux ouvriers catholiques que notre sympathie leur est acquise d’une manière effective et réelle. Ce serait d’ailleurs jouer un rôle de dupes, et ne tenir aucun compte des intérêts les plus sacrés, que de placer sur le même rang ceux qui pratiquent notre foi et ceux qui la combattent. Nous devons la charité à tous, mais non pas indistinctement et sans suivre l’ordre indiqué par la nature même des choses. Il y a une gradation dans nos devoirs comme il y a des degrés dans le mérite. Vos listes de travailleurs chrétiens ne sont autre chose que la mise en pratique de ce précepte inéluctable de l’Apôtre : Faisons du bien à tous, mais surtout aux serviteurs de la foi. »
La Société de Saint-Joseph, branche de la Société protectrice du travail et de la vertu, regroupait en mars 1878 pour la ville d’Angers : 324 affiliés patrons, commerçants ou artisans et ouvriers. Le 27 janvier 1878, Le Père Ludovic de Besse fondait aussi la Banque populaire d’Angers, œuvre tout à fait originale, unique en France. C’est, en fait, beaucoup plus une « œuvre chrétienne », selon l’expression même du Père Ludovic, qu’une simple banque : « Elle a pour but de rapprocher toutes les classes, d’unir dans une même entreprise, le travailleur, le capitaliste et le prêtre. C’est une œuvre de fraternité chrétienne et de paix sociale. C’est pourquoi nous pouvons fermement compter sur les bénédictions de Dieu. »
Dans un remarquable article de l’Association catholique, Ferdinand Hervé-Bazin, qui en fut un temps directeur, montre le caractère contre-révolutionnaire de cette œuvre :
« Les sociétés coopératives d’Italie, d’Allemagne, de Belgique sont formées entre ouvriers, à l’exclusion systématique du capital. Et cela dans le but de tenir en échec le capitalisme et d’apprendre aux ouvriers à se grouper, à se diriger entre eux, les sociétaires doivent s’administrer démocratiquement.
« Si les fondateurs de ces associations populaires ont cru rendre service aux sociétés modernes, ils se sont trompés ! Si leurs intentions ont été droites, elles n’ont certes pas été justes et l’avenir le prouvera bientôt. Isoler les travailleurs des autres parties de la nation, c’est perpétuer les agitations et donner un aliment formidable aux agitations et aux revendications sociales. Ce qu’on croit enlever aux grèves, on le donne à la Révolution, loin d’aider à la restauration des principes sur lesquels reposent les nations, on organise une ligue ouvrière qui, tôt ou tard, tombera dans les filets du socialisme. »
Que fut donc cette Banque populaire d’un genre encore inconnu en France ? Elle n’était ouverte qu’aux travailleurs « chrétiens et vertueux ». La seule garantie exigée était une garantie morale, une bonne renommée de vertu et le goût de l’épargne. Ainsi, par exemple, à un ouvrier se montrant capable d’économiser 10 francs, la banque, considérant ce geste de bonne volonté, lui consentait un prêt de 20, 50, 100 francs ou même plus, dont il avait besoin pour l’achat des matières premières ou des machines nécessaires au développement de son entreprise. Dès les cinq premiers mois de son fonctionnement, la Banque populaire d’Angers prêta 52 935 francs à soixante sociétaires appartenant à trente professions différentes.
En 1879, eut lieu à Angers, dans le cadre même de l’Université catholique, un congrès national des œuvres ouvrières, présidé par Mgr Freppel. Ce fut la première rencontre entre l’évêque et le grand défenseur du catholicisme intégral belge, Charles Périn. Celui-ci, professeur d’économie sociale à l’université catholique de Louvain, deviendra alors l’ami et le maître de Ferdinand Hervé-Bazin et de René Bazin.
En 1880, Ferdinand Hervé-Bazin, sur l’ordre de Mgr Freppel fonde avec le Père Ludovic l’Union économique, nouveau journal destiné à faire connaître et à développer les banques populaires sur le modèle de celle d’Angers. Mais on y trouve aussi des articles sur tout ce qui se fait en Europe en faveur des ouvriers...
Extraits de Il est ressuscité ! n° 56, avril 2007 p. 17-18
et de Mgr Freppel, Tome 4 : « J’ai lutté seul », 1887-1891, p. 343-383