Réfutation prophétique du socialisme d’État
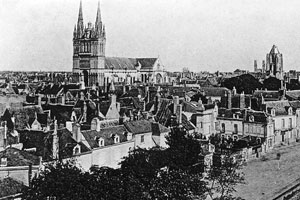
Le 7 octobre 1890, lors du Congrès des jurisconsultes catholiques à Angers, Mgr Freppel prononça un discours que Mgr Mermillod appela “ La bombe d’Angers ” et qui vaudra à son auteur d’être traité de libéral !
Citons largement ce discours qui résume bien la doctrine sociale de l’évêque : « Jurisconsultes chrétiens, vous avez à examiner où se trouve le droit et ce que réclament les principes ; car, en dehors du droit, il n’y a qu’injustice, et sans les principes, on ne peut rien construire de solide et de durable, même avec les meilleures intentions du monde. »
Après avoir, une nouvelle fois, dénoncé l’ingérence de l’État dans cette question, Mgr Freppel expliquait :
LA FONCTION DE L’ÉTAT
« L’État, et c’est précisément sa raison d’être, l’État a pour mission de protéger tous les droits sans exception ; surtout à l’égard des petits et des faibles. Mais nous sommes depuis quelque temps en présence d’une théorie qui a une tout autre portée. Il y a, en effet, un abîme entre cette proposition : “ L’État intervient comme gardien de la justice et de la morale dans l’observation du contrat de travail ”, ce qui est son droit ; et cette autre proposition : “ L’État intervient pour fixer lui-même les termes du contrat ”, ce qui est le pur socialisme d’État.
« C’est ainsi, pour me servir d’un exemple, que la différence est du tout au tout, suivant que l’on dit : “ L’État a le droit de réprimer les abus de la puissance paternelle ”, ce qui est la vérité ; ou bien : “ L’État a le droit de se substituer au père et à la mère pour régler le régime intérieur de la famille ”, ce qui est une erreur. Partant de cette confusion, on attribue au législateur le droit de fixer la limite maximum de la durée du travail journalier même pour les ouvriers majeurs ; le droit d’imposer aux chefs d’entreprise un minimum de salaire ; et enfin, le droit de fixer la proportion entre les salaires et les bénéfices commerciaux et industriels. » (...).
“ LE JUSTE SALAIRE ” DES CATHOLIQUES SOCIAUX
Puis, abordant la question épineuse du juste salaire proportionné aux besoins de la famille de l’ouvrier, il expliquait : « “ En bonne justice, le salaire de l’ouvrier doit être proportionné à ses besoins, et non seulement à son travail. ” Ici, on confond manifestement la justice et la charité. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Du moment que le travail est rémunéré au prix convenu et dans une proportion équitable avec ce qu’il produit par lui-même, de ce seul fait, le devoir de la justice est rempli ; le reste est l’affaire de la charité. » Si Mgr Freppel se montrait si opposé au salaire familial, c’était d’abord pour une simple raison de bon sens. Si les patrons devaient payer plus cher un ouvrier chargé d’une famille nombreuse, la conséquence directe serait que les patrons n’emploieraient plus que des célibataires.
Aussi l’évêque se montrait-il plutôt favorable à ce que nous appelons les allocations familiales, mais là encore, sa prudence lui faisait refuser que ces allocations soient confiées à l’État, fixant un barème identique pour tous au prorata du nombre d’enfants. Mgr Freppel aurait voulu qu’elles soient confiées aux corporations, autorisées à gérer un patrimoine corporatif. Ces corporations connaissant les vrais besoins de chacun de leurs membres, seraient à même de fournir à tous un secours proportionné à leurs besoins réels, en évitant la gabegie inévitable dans un système étatique. « L’État est le gardien de la justice, custos justi, tant que l’on voudra ; mais il n’y a aucun principe qui l’autorise à convertir en obligations de justice les actes de la charité particulière. »
Quant à la question du salaire en lui-même, l’évêque d’Angers refusait qu’il soit « la juste compensation de la renonciation de l’ouvrier au profit de son travail. Ou ces mots ne signifient rien, ou ils veulent dire que l’ouvrier devient copropriétaire ou co-usufruitier du champ, de la mine ou de la manufacture. Car l’on ne peut renoncer à sa part dans les revenus d’un bien ou dans les bénéfices d’une entreprise, qu’à la condition de posséder là-dessus un droit de propriété ou d’usufruit. » Un tel principe serait la négation de la propriété individuelle et donnerait raison au socialisme international. « On peut assurément – et cela est très louable – stipuler par des conventions positives, acceptées de part et d’autre, la participation des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise ; mais l’ériger en principe absolu et la proclamer de plein droit, en soutenant que le salaire n’est que la juste compensation de la renonciation à l’exercice de ce droit, cela me paraît chose aussi grave en conséquences que mal fondée en raison. »
RÉFUTATION DE MARX ET DU SOCIALISME D’ÉTAT
Enfin, s’attaquant au principe même de la doctrine de Karl Marx, Mgr Freppel expliquait : « Pour justifier l’intervention abusive de l’État dans la question ouvrière, on pousse à un degré que je n’ai jamais pu comprendre, l’antithèse entre le capital et le travail, comme s’il s’agissait là de deux notions absolument contradictoires. Mais est-ce que le capital, lui aussi, ne représente pas le travail ? Qu’est-il autre chose, sinon une accumulation de travail, de père en fils, d’une génération à l’autre ? Et lors même qu’il serait le fruit de l’intelligence et de l’activité d’un seul homme, le travail y entrerait toujours pour une grande part. J’ai connu en Alsace – et c’est l’un des meilleurs souvenirs de ma vie – un simple ouvrier mineur parvenu, à force d’application et de patience, à l’une des plus hautes situations industrielles de France. Comment dénier à cet homme la qualité de travailleur ? Et de quel droit l’État viendrait-il entraver son œuvre par des règlements de toute sorte, sous prétexte de protéger ceux qu’une égale dose de volonté et de savoir-faire aurait pu conduire au même point de prospérité ? »
Avec ce réalisme, ce bon sens qui le caractérisait, il ajoutait : « On dit enfin que la liberté de l’ouvrier, dans le contrat de travail, est purement illusoire, que c’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, et, que, par suite, l’État doit jeter dans la balance le poids de son autorité pour rétablir l’équilibre. Mais c’est là encore une de ces formules où l’on se paie de mots plutôt que de raison.
« Aujourd’hui que les masses ouvrières ont dans leurs mains cette double arme qui s’appelle le droit de coalition et le droit de grève, menace permanente pour les chefs d’entreprise, il est permis de se demander de quel côté se trouve réellement le plus de liberté et d’indépendance. Qui est le mieux garanti contre l’avenir ? Qui a le moins de sécurité ? Pour moi, la réponse est à tout le moins douteuse, quand je songe que ce patron qui a mis dans l’entreprise toute sa fortune, l’héritage de ses pères, l’avenir de ses enfants, est tellement à la merci de ses ouvriers qu’il peut suffire d’une excitation produite par quelques meneurs pour consommer sa ruine, tandis que les portes de l’établissement rival s’ouvriront à ceux qui, par leur refus de travailler au moment le plus critique, l’auront irrémédiablement perdu. Il y a là, pour le patron, des causes de dépendances, j’oserai dire de faiblesse, sur lesquelles il est impossible de fermer les yeux, si l’on veut être impartial et envisager la question sous tous ses aspects.
« Messieurs, il faut dire les choses telles qu’elles sont, sans se soucier d’une popularité facile à conquérir, mais aux dépens du droit et de la vérité. Assurément, les souffrances occasionnées par les transformations de l’industrie moderne sont grandes, et ce n’est pas ici que l’on pourrait nous reprocher d’y être insensibles, dans une ville où abondent les œuvres et les corporations ouvrières. Mais, de grâce, ne recourons pas à des remèdes qui pourraient facilement devenir pires que le mal. N’allons pas ajouter, à profusion, de nouvelles contraintes légales à celles qui, déjà, nous enserrent de toutes parts, pour l’enseignement et l’éducation comme pour le reste. Faut-il donc absolument multiplier les sanctions pénales, et lever à grands frais des légions de fonctionnaires et d’inspecteurs pour faire régner dans le monde du travail la raison et la justice ? La conscience moderne est-elle tellement oblitérée qu’il ne faille plus compter sur elle pour la direction des actes humains ? Et, à défaut même d’une conscience plus délicate, n’est-ce plus rien comme mobile de conduite, que l’intérêt personnel, l’intérêt bien entendu, pour défendre le patron contre les excès qui tourneraient à son détriment, et l’ouvrier contre les abus de ses forces et le gaspillage de sa vie ?
« L’Église n’est-elle plus là, l’Évangile à la main, pour généraliser de plus en plus ces dévouements, et faire triompher ainsi la justice et la charité ? Il ne faut donc pas se hâter de jeter vers les pouvoirs publics un appel aussi désespéré lorsqu’on peut mettre en jeu tant d’autres forces réunies. Et maintenant, Messieurs, il faut conclure, au socialisme d’État, sous quelque forme qu’il se produise, opposons les deux principes de la liberté du travail et de la liberté d’association.
« La Révolution française a gâté les réformes même les plus légitimes parce qu’elle se plaçait en dehors des principes pour sacrifier à des utopies. En même temps qu’elle proclamait la liberté du travail à la suite des cahiers de 1789, elle détruisait ce qui en est le complément naturel, le corollaire logique et le correctif indispensable, la liberté d’association. Et nous voici occupés depuis cent ans à réagir, à notre tour, contre cette fatale erreur de 1791, à reconstituer peu à peu et péniblement le droit des ouvriers à l’association par les sociétés de secours mutuels, par les caisses de pensions de retraite, par des banques populaires, par les sociétés coopératives, par les syndicats professionnels, en un mot, par le rétablissement, sous une forme ou une autre, du régime corporatif.
« Qu’est-ce à dire, Messieurs ? Songeons-nous, le moins du monde, à faire revivre les corporations obligatoires et fermées, au risque de porter atteinte à la liberté du travail ? Tel ne saurait être raisonnablement notre but ; tel n’est pas, en tout cas, mon idéal dans les conditions de l’industrie moderne. Nous voulons combiner, dans une alliance féconde, le principe de la liberté du travail avec le principe de l’association libre et volontaire. Nous voulons des corporations pouvant se former librement entre patrons et ouvriers ; des unions de métiers ayant la faculté de créer et d’entretenir, sous la protection des lois, leurs œuvres de secours et de prévoyance en faveur des enfants, des veuves, des vieillards, des invalides du travail, sans être entravés dans leurs développements par des restrictions méticuleuses au droit de propriété collective, soit mobilière, soit immobilière ; en un mot, de vraies associations ouvrières, ayant comme autrefois leur patrimoine corporatif sous l’égide du droit public et de la Religion.
« C’est à provoquer l’initiative personnelle et l’action collective que doivent tendre nos efforts, si nous voulons résoudre la question ouvrière conformément aux lois de la justice et de la charité. Laissons à l’État, au législateur, aux pouvoirs publics de tout ordre, leur vraie fonction qui est de protéger tous les droits, et plus particulièrement les droits des petits et des faibles ; mais n’allons pas leur demander ce qui ne rentre nullement dans leurs attributions. Ce serait la mainmise de l’État sur toutes les conditions de l’activité humaine. »
L’évêque d’Angers faisait d’ailleurs remarquer, avec une pointe d’humour grinçante, que ce même ouvrier que l’État plongeait dans « une dépendance et une sujétion absolue » pour tout ce qui dépendait de son métier depuis la loi Le Chapelier, le même État lui attribuait assez « d’intelligence pour contribuer à former les pouvoirs publics » par le droit de vote.
« Je ne saurais me résoudre à voir la France catholique emboîter le pas aux pays protestants où la contrainte légale, par voie de pénalités, a pu paraître indispensable pour suppléer à l’insuffisance du dévouement et de la charité. Liberté individuelle ; liberté d’association avec toutes ses conséquences légitimes ; intervention de l’État limitée à la protection des droits et à la répression des abus : voilà, Messieurs, ma formule dans la question du travail ; laissez-moi espérer que telle sera aussi la vôtre. »
Mgr Freppel, Tome 4 : « J’ai lutté seul », 1887-1891, p. 361-366