LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918
6. Les années Pétain (I)
Verdun, la gloire héroïque (1916)

À la fin de l’année 1915, alors qu’on ne savait pas encore si l’on devait viser à la paix par une hécatombe de soldats ou par des manœuvres militaires et une grande percée définitive, le généralissime Joffre, tout frémissant de son pouvoir total, offrit aux alliés un projet grandiose d’attaque sur la Somme, conduit en accord avec son ami Haig, mais sans consulter son adjoint Castelnau. Ce projet devait mobiliser toutes les énergies de l’armée pendant l’année 1916.
Sans le dire, Joffre était extrêmement impressionné par la “ méthode Pétain ”, comme il dira, méthode qui avait valu au 33e corps les seuls succès notables de 1915. Il recommanda donc une grande préparation d’artillerie qu’il appelait l’usure, cette usure devant provoquer la rupture chez l’ennemi. Foch, qui se voyait déjà le grand victorieux, ajoutait que les armées, poussées en avant dans la brèche devaient aussitôt poursuivre l’ennemi et le forcer à la paix.
Pétain, lui, était beaucoup plus réservé. Il avait succédé à Castelnau comme chef de la IIe armée et s’était mis en “ disposition ”. Il comprenait trop bien qu’on le laissait sur la touche parce qu’on le jugeait trop attentiste et pas assez enthousiaste.
Pourtant, 1916 s’annonçait mal. D’inquiétants craquements commençaient à se faire sentir d’un côté où Joffre ne voulait pas les voir : Verdun.

Le 1er décembre 1915, le colonel Driant, chef de deux bataillons de chasseurs en première ligne à Verdun, faisait un rapport alarmant au général Gallieni, disant que les avant-postes qu’il occupait étaient pratiquement livrés à l’ennemi : point de retranchement, point de barbelés, point de postes d’observation, etc. Joffre, furieux de recevoir ce rapport par l’intermédiaire de Gallieni — qui était ministre de la Guerre tout de même — n’en tint aucun compte. « À mon avis, lui répondit-il, rien ne justifie les craintes que vous avez exprimées au nom du gouvernement dans votre dépêche du 16 décembre. »
Joffre ne croira à l’attaque allemande sur Verdun qu’au moment où elle se déclenchera. (...)
Pourtant, le colonel Driant était pour le moins digne de confiance ! Il avait écrit un livre : « Vers un nouveau Sedan », où il prévoyait de loin l’enchaînement des évènements qui ferait de Verdun la cible de choix de Guillaume II. Mais ce militaire de prestige, gendre du général Boulanger, qui avait été exclu de l’armée lors de l’affaire des fiches, n’était pas dans les bonnes grâces du G.Q.G., car il avait jadis, comme député de Nancy, protesté contre la désignation de Joffre à la tête du grand état-major français. (...)
Par pur patriotisme, Driant avait demandé à reprendre sa place au combat, et on l’avait mis à la tête des chasseurs du Bois des Caures, au nord de Douaumont. Très courageusement, il avait commencé à faire des travaux de défense, mais sans aucun soutien de l’état-major.
Un autre signal d’alarme était venu du général Herr, chef de la région fortifiée de Verdun (R.F.V.). Quant à de Langle de Carry, chef de cette même région en 1915, il s’était lui-même étonné de ce que le gouvernement passait une loi sur l’inutilité des zones fortifiées et le démantèlement des forts !
De fait, Douaumont, en janvier 1916, était en train de perdre ses canons : on devait les transporter sur la Somme pour la belle aventure dont rêvaient Joffre et Foch ; et cet immense fort de 20 hectares, point de mire de l’armée allemande, n’était occupé que par 60 hommes de la réserve... Formidable insouciance de la part du commandement français !
LE CHOC (21-25 FÉVRIER)

La zone fortifiée de Verdun est comme un porte-avions ancré entre la vallée de la Meuse et la plaine de la Woëvre, et c’est sur ce front extrêmement étroit de douze kilomètres que les défenseurs de Verdun ont reçu toute l’impétuosité de l’attaque allemande. Prévue le 12 février, celle-ci n’eut lieu que le 21 février à cause des pluies abondantes, retard sauveur, qui a permis aux nôtres de parer le choc.
Plutôt que de vous parler de l’héroïsme des soldats, qui est absolument unique dans l’histoire, mais qui est très connu, et du détail de l’organisation, parce que nous n’en sortirions pas, je vais vous montrer ce que devient la stratégie entre les mains de chefs insuffisants et entre les mains de chefs compétents. C’est le jour et la nuit, et cela se marque par des victoires ou par des défaites. Et, par-dessus cela, nous verrons le mal causé par les querelles des chefs, chose qui est vieille comme l’Iliade, et qui est la mort des nations.

L’attaque du 21 février sur le secteur central de douze kilomètres de front porte sur le Bois des Caures. Attaque formidable, préparée de longue date dans le plus grand secret par la Ve armée allemande, le Kronprinz en tête : voies ferrées construites pour concentration des feux et abris dans des casemates, 140 000 hommes, un stock de 2 500 000 obus, 1 220 tubes d’artillerie, 306 pièces de montagne, 542 canons lourds, 152 mortiers puissants et 168 avions.
Après une telle préparation d’artillerie, les Allemands s’avançaient l’arme à la bretelle dans cette forêt ravagée, sûrs de ne plus trouver âme qui vive. Or ils ont trouvé les chasseurs à pied de Driant, avec leurs mitrailleuses. Ceux-ci tiennent, reculent, recommencent, remettent leurs mitrailleuses. Ils vivent là des heures héroïques, mais sont finalement obligés de céder du terrain peu à peu. Le 22 février, les Allemands ont absorbé le Bois des Caures. On commence à s’inquiéter dans l’armée. Le 23 février, ils font un nouveau bon de quelques centaines de mètres, ce qui est assez misérable pour un tel déploiement de force. Le feu roulant d’artillerie reprend le 24 et, le 25 février, c’est presque la débandade du côté français. (...)

Les Allemands couvrent la rive de la Meuse à l’ouest, la côte de Talou, et se dirigent vers Douaumont. Là se produit l’épisode le plus pitoyable de cette guerre peut-être. Il a été raconté de façon un peu romancée par l’un des assaillants allemands. Ils étaient tous pétrifiés devant cette immense coupole silencieuse, persuadés qu’on les attendait là au pied, dans les fossés, pour être balayés et exterminés. Puis l’un a sauté d’un côté, un autre est passé par une meurtrière... Rien ! Elle était vide. Ils ont trouvé 63 réservistes au deuxième sous-sol, qui ne savaient pas ce qui se passait. Épouvantable faute de commandement !
Douaumont était pris sans coup férir. On l’a aussitôt claironné dans toute l’Allemagne : on avait gagné la guerre ! (...)
Ils se pressaient un peu...
Pendant ce temps-là, Castelnau disait à Joffre qui dormait :
– Il faut s’occuper de Verdun !
– Mais non, il n’y a rien, il n’y a rien !
– Faites-moi au moins un papelard. ... Et Joffre a griffonné sur un carnet qu’il donnait tous les pouvoirs à Castelnau, qui est parti sur l’heure. Il est arrivé à Verdun le 25 au matin, au moment où la débâcle commençait.
Il a repris les choses avec fermeté, redonnant du moral aux soldats. Il a prévenu Pétain qu’il le nommait chef de la rive gauche, tandis qu’il sommait – un peu brutalement – les généraux de Langle de Carry et Herr de tenir la rive droite. Il est reparti le 25 au soir ou le 26 au matin.

Pétain est arrivé le 26 à 00h01, juste à temps pour arrêter un repli désastreux sur la Meuse, de Charny à Belleville. Il appelle le général Balfourier et, avec sa voix calme :
– Allo ! C'est moi, général Pétain. Je prends le commandement. Faites le dire à vos troupes. Tenez ferme. J'ai confiance en vous.
– C'est bien mon général. On tiendra ! Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous.
Pétain avait un immense ascendant sur les hommes de troupe et sur les généraux. (...)
À Paris, députés et ministres avaient besoin d’une victime pour la perte de Douaumont, et c’est Gallieni qui a payé pour les autres. Il a été mis en minorité à la Chambre d’une manière honteuse, il a été contraint de démissionner. Il mourra quelque temps après.
Gallieni est un très grand général qui avait la confiance de Pétain et qui sera indignement traité par les parlementaires. Citons-les ! il le faut, pour vous montrer le contraste entre l’héroïsme du front et la vulgarité de ces hommes. Briand : « C’est une vessie que nous avions prise pour une lanterne », il faisait allusion à son opération de la prostate. Et Clemenceau : « Veni, vidi, vessie ! » Imaginez !
Gallieni n’avait pas la foi, c’est la seule chose qui lui manqua. Il fut remplacé par Rocque, une nullité, un ami de Joffre. Tout aurait été de mal en pis si Pétain n’était pas allé à Verdun.
LE RÉTABLISSEMENT
Il a aussitôt mis de l’ordre. Il a rendu à chaque chef de corps d’armée son terrain, a fixé les endroits où il ne fallait pas reculer d’un centimètre, a justifié le général de Langle de Carry d’avoir abandonné la Woëvre. Il a ensuite annulé l’ordre de Castelnau qui était parti en disant qu’il fallait reconquérir immédiatement Douaumont. On ne reconquiert pas un fort comme ça, quand on est en pleine débâcle ! (...)
Depuis le début, avant même d’être nommé par Castelnau, Pétain avait son idée sur la stratégie de Falkenhayn. Il se disait : s’il attaque sur la rive droite, c’est qu’il veut nous attirer sur ces plateaux, et quand nous aurons fait traverser la Meuse à toutes nos troupes, il attaquera soudain de l’autre côté, à l’ouest, et prendra la ville de Verdun. Ce serait exactement un nouveau Sedan, comme l’avait prévu Driant.

Pétain dirige la bataille de Verdun en conséquence, déployant un génie logistique et stratégique sans précédent. L’exploit logistique, c’est avant tout la mise en œuvre de la “ Voie sacrée ”, cet unique chemin par où transitèrent les milliers de tonnes de munitions, matériel, ravitaillement, et surtout la noria continuelle des combattants venant relever les premières lignes pour ne pas laisser les soldats trop longtemps sur le front.
Il faut absolument que je prenne le temps de vous lire le texte le plus remarquable de la guerre, qui dit de façon extraordinaire ce qu’était le cœur de Pétain. C’est dans tous les livres, évidemment. Il faudrait le savoir par cœur, on devrait le faire réciter aux enfants !

Mon cœur se serrait quand je voyais aller au front de Verdun nos jeunes gens de vingt ans, songeant que, avec la légèreté de leur âge, ils passeraient trop vite de l’enthousiasme du premier engagement à la lassitude provoquée par les souffrances, peut-être même au découragement devant l’énormité de la tâche à accomplir. Du perron de la mairie de Souilly, mon poste de commandement si bien placé au carrefour des chemins conduisant vers le front, je leur réservais ma plus affectueuse attention quand ils montaient en ligne avec leurs unités. Cahotés dans les inconfortables camions ou fléchissant sous le poids de leurs appareils de combat quand ils marchaient à pied, ils s’excitaient à paraître indifférents par des chants ou des galéjades et j’aimais le regard confiant qu’ils m’adressaient en guise de salut. Mais quel découragement quand ils revenaient, soit individuellement comme éclopés ou blessés, soit dans les rangs de leurs compagnies appauvries par les pertes. Le regard insaisissable semblait figé par une vision d’épouvante. Leur démarche et leur attitude trahissaient l’accablement le plus complet. Ils fléchissaient sous le poids de souvenirs horrifiants. Ils répondaient à peine quand je les interrogeais et, dans leurs sens troublés, la voix goguenarde des vieux poilus n’éveillait aucun écho.
Pour ce qui est de la stratégie, elle consiste d’abord dans la réorganisation de l’artillerie, constituée en “ réduit de feu ” sur la rive gauche de la Meuse, autour des forts de Vacherauville, de Marre et de Bois-Bourrus, et pilonnant sur son flanc la masse allemande en mouvement. Falkenhayn, en effet, selon la prévision de Pétain, répétait la manœuvre de von Kluck en 1914 : il obliquait à l’est, présentant son flanc à la Meuse. (...)

Ensuite, rive droite, Pétain fixa impérativement une ligne de résistance autour de Thiaumont, Fleury, Souville et Tavannes. C’était la ceinture de protection de Verdun, elle-même protégée d’une attaque à revers par le fort de Vaux. Le front fut stabilisé le 1er mars. (...)
À ce moment, Falkenhayn, pour échapper à l’artillerie française, transporta son effort sur la rive gauche. Le 6 mars, nouvelle attaque-surprise, formidable, mais que Pétain attendait... On commença par céder du terrain le 7 mars jusqu’à la côte de l’Oie, mais le 8 mars, Pétain, assuré de sa manœuvre, pouvait déjà lancer une contre-offensive au Bois des Corbeaux, où nous étions retranchés, sur un terrain qu’il avait choisi et qui nous était propice.
On fait la différence avec le 21 février ! Les soldats étaient reconnaissants de ce recul stratégique, et ils se sentaient commandés.
Cependant, l’attaque allemande reprit son cours, tout aussi formidable qu’au Bois des Caures. Ils progressèrent encore le 14 mars, mais ils s’arrêtèrent au pied du Mort-Homme, cette célèbre colline qu’aucun combattant la Grande Guerre n’ignore, qui a été prise et reprise de façon continuelle pendant deux mois.
C’est le 9 avril, après la perte du mont, que Pétain, cœur à cœur avec ses soldats, lança son fameux : « courage, on les aura ! » (...)

LA TRAHISON
Mais déjà, il était trahi par ses chefs...
Le 9 mars, au lendemain de la contre-attaque du Bois des Corbeaux, le président Poincaré lui rendait visite. Ce Poincaré n’était pas un mauvais homme, il reviendra de ses erreurs, mais ce jour-là, quand Pétain lui a montré le terrain regagné sur l’ennemi pour qu’il puisse redonner un peu de confiance à Paris, il s’est dit : « C’est tout ? » C’était un parfait ignorant des choses de la guerre, il ne pouvait pas se rendre compte... mais quand il est retourné à Chantilly, il a trouvé là Joffre et Foch qui ont renchéri et se sont mis à critiquer le général Pétain : « Mais bien sûr, il fallait attaquer, il a trop peur, il demande toujours davantage d’artillerie, il n’y a qu’à foncer ! », etc.
On se souvient de l’échange que Pétain avait eu avec Poincaré. En substance, il se résume ainsi :
– Monsieur le Président, tout ne pourrait marcher bien que si le chef de l’État, en temps de guerre, exerçait une véritable dictature.
– Mais, général, la Constitution, qu’est-ce que vous en faites ?
– La constitution ? Moi, je m’en fous !
C’est ainsi que Pétain se faisait mal voir des politiciens, mais il faisait la guerre sérieusement, et il avait à faire à des gens superficiels.
Le 11 avril, c’était Joffre qui venait voir Pétain à Souilly. On lui avait répercuté le « Courage, on les aura », du 9 avril.
« Puisque ça va, dit-il, il faut tout de suite réattaquer ! »
Je suis persuadé que Joffre n’avait qu’un but. Il venait voir sur place, s’assurer si les choses allaient vraiment bien, et quand Pétain lui a expliqué que nous étions de nouveau maîtres de nos mouvements, il s’est dit : « demain, il va être le grand vainqueur de la guerre, il faut absolument l’écarter pour que ça soit moi, le chef, qui soit vainqueur. »

Il explique dans ses Mémoires avec un aplomb stupéfiant : « Vers le début d’avril, je cherchai le moyen d’éloigner le général Pétain du champ de bataille de Verdun, espérant que, en lui donnant plus de recul et un front plus vaste à diriger, il se rendrait mieux compte de la situation générale. » C’est le premier grand crime de la guerre : Joffre évacue Pétain de la bataille. Et je ne pardonne pas à Castelnau de s’être aligné sur lui à ce moment-là.
Le 25 avril, à Souilly, il lui annonce sa promotion — promoveatur ut amoveatur — comme chef du Groupe des armées du Centre. Donc il monte d’un grade et va avoir un commandement plus étendu. À ce poste, il a continué à organiser la noria des troupes fraîches pour monter à Verdun, en faisant participer toutes les armées du centre. Il aurait voulu que toute l’armée française prenne part à ce sacrifice, mais pas question ! Il fallait garder nos réserves pour la Somme.
Il y avait mille canons rassemblés pour l’offensive de la Somme. Pétain demandait des canons pour défendre le Mort-Homme et Foch lui disait : « Inutile, vous réclamez trop, on ne peut pas vous les donner, c’est de côté pour la Somme. » Pétain répondait : « Si nous sommes battus aujourd’hui, à quoi serviront les mille canons sur la Somme ? »
LE RECUL

Qui va lui succéder à Verdun ? Nivelle et Mangin, deux coloniaux très bagarreurs, mais des têtes brûlées. Ils ne demandaient pas de matériel, eux, ils se lançaient à l’assaut... (...)
Mais, du jour au lendemain, c’est comme un froid qui pénètre le cœur de tous les soldats.
Le 19 mai, Nivelle prétend attaquer sur la rive gauche. En fait, il cède du terrain : on perd à nouveau le Mort-Homme et Cumières.
Ensuite, Mangin s’imagine qu’il va reconquérir Douaumont. Pétain y consent à contrecœur. On lui donne de l’artillerie, mais il ne reçoit qu’une division au lieu des quatre qu’il avait demandées. Et voilà notre Mangin – qu’on appellera le boucher – qui part à la conquête de Douaumont. Mais le fort a été solidement fortifié par les Allemands depuis deux mois. En une journée, il perd 5500 hommes et 130 officiers. (...)

Les Allemands descendent ensuite et attaquent le fort de Vaux. Nivelle, qui commande ce secteur, tente de ravitailler le fort, en vain. Les soldats résistent pendant toute une semaine, sans boire, asphyxiés par les gaz, communiquant par pigeons, puis par signaux optiques. Quand le fort est livré, le Kronprinz est absolument dans l’admiration de ce que ces hommes ont fait. Mais enfin, cette chute mine le moral de l’armée.
Nivelle veut alors rendre à l’armée son moral, à sa manière : il fait fusiller les lieutenants Herduin et Milan par leurs propres hommes, parce qu’ils ont cru devoir se replier après une résistance héroïque où leurs compagnies étaient passées de 200 à 35 hommes. (...)
Le 23 juin, les Allemands jettent toutes leurs ressources sur les forts de Thiaumont, de Fleury, et de Souville.
Les 11 et 12 juillet, malgré l’offensive de la Somme qui a été lancée le 1er juillet, ils renouvèlent leurs assauts sur Fleury et Souville avec une telle fureur de désespoir qu’ils parviennent à la chapelle Sainte-Fine, dernier promontoire avant la descente finale qui leur aurait livré la ville de Verdun.
Au fort de Souville, le lieutenant Dupuy continue à se battre avec ses rescapés. Quand la nuit tombe, on leur dit de tenir encore. Ils attendent le lendemain en sachant que ce sera le jour de leur mort.
Le lendemain, le 12, le Kronprinz donne l’ordre de se tenir désormais sur une stricte défensive. Et nos soldats, qui se préparaient à recevoir les Allemands, s’aperçoivent qu’ils ont déguerpi. Vraiment, la Providence est avec les Français ! Si le Kronprinz avait su dans quel état étaient nos hommes, il n’aurait jamais donné cet ordre et Verdun aurait été prise. C’était le 12 juillet.
LE RETOUR DE PÉTAIN

Aussitôt les Allemands arrêtés, Nivelle et Mangin lancent une contre-attaque, du 15 au 18 juillet, mais dans un tel désordre et avec des troupes tellement épuisées que Pétain intervient.
Il revient de sa propre autorité, car il est quand même leur chef et il va leur apprendre à travailler. Il veut reconquérir les forts perdus, mais pas avant d’avoir le matériel nécessaire. Il commence par commander deux obusiers de 400 pour crever les superstructures : l’artillerie d’abord, les soldats ensuite !
Trois batailles sont à retenir : la reprise de Douaumont le 24 octobre, préparée par un tel flot d’artillerie que l’infanterie a pu pénétrer le fort avec très peu de pertes, la reprise de Vaux le 2 novembre, puis la grande remontée du 15 décembre qui reprend les fortifications françaises les plus avancées.
C’est Pétain qui a sauvé Verdun, et non pas Nivelle et Mangin, comme le croiront les parlementaires et politiciens.
L’OFFENSIVE DE LA SOMME

Pendant tout ce temps, Joffre ne cessait de préparer son offensive sur la Somme. Cette offensive, censée soulager Verdun en déplaçant l’effort de guerre allemand, n’a pas eu l’effet escompté. Dans l’esprit des Allemands – Ludendorff et Hindenburg ayant succédé à Falkenhayn – Verdun devait être à tout prix l’empoignade finale. En outre, grâce à leurs espions, ils ont vu venir de loin notre attaque sur la Somme. Ils connaissaient à peu près la date et s’y sont préparés par des fortifications que nos troupes n’ont pas pu enfoncer.
Tout, dans cette offensive, n’a fait que vérifier les prédictions de Pétain. (...)
Il faut mentionner, tout de même, la part prise par les Canadiens français, qui se sont illustrés dans la conquête de Courcelette, mais c’est intéressant de les voir se heurter aux mêmes problèmes que nous dans l’armée anglaise, et aux mêmes erreurs soutenues par des généraux aussi incompétents. (...)
 Du côté français, c’était la VIe armée du général Fayolle qui entrait en jeu. Fayolle était un disciple de Pétain, mais il recevait sans cesse des coups d’épée dans les reins de la part de Foch, qui lui disait de foncer, foncer, toujours foncer ! C’est ainsi qu’au dixième jour de l’offensive le 10 juillet, il a dû engager ses troupes dans les marais de Péronne, et ce fut l’enlisement, la fin de l’avancée française. Joffre et Foch se sont obstinés jusqu’en novembre, sans aucun résultat.
Du côté français, c’était la VIe armée du général Fayolle qui entrait en jeu. Fayolle était un disciple de Pétain, mais il recevait sans cesse des coups d’épée dans les reins de la part de Foch, qui lui disait de foncer, foncer, toujours foncer ! C’est ainsi qu’au dixième jour de l’offensive le 10 juillet, il a dû engager ses troupes dans les marais de Péronne, et ce fut l’enlisement, la fin de l’avancée française. Joffre et Foch se sont obstinés jusqu’en novembre, sans aucun résultat.
C’est là qu’ils ont commencé à se haïr tous les deux, Joffre, à court d’hommes et de matériel, voulant réduire ses ambitions, tandis que Foch s’accrochait encore à sa grande bataille finale qui devait faire de lui le vainqueur de la guerre.
Bilan de la Somme : en cinq mois, les Anglais ont perdu 400 000 hommes et les Français, 200 000, contre 300 000 pour les Allemands. Voilà comment les généraux jouent avec les centaines de milliers d’hommes comme si c’étaient des pions !
CHANGEMENTS AU G.Q.G.
À la fin de cette bataille, les parlementaires, qui ne comprennent rien et sont toujours en retard, ont découvert que Briand était un incapable et Joffre l’inertie personnifiée.
Un autre drame est survenu alors, qui a mis la Chambre en émoi : le guet-apens d’Athènes. Sarrail était toujours en Grèce avec son armée. Il devait partir de Salonique monter jusqu’au Danube, serrer la main aux Russes en passant et prendre les Autrichiens à revers. Une opération qu’il mènera dans des conditions très très difficiles.
Le roi de Grèce, voyant que la Roumanie était écrasée, que la Serbie avait été occupée par les Bulgares et les Autrichiens, que nous étions en train de perdre tous nos alliés en Orient, a cru qu’il devait changer de camp et, pour renverser les alliances, il a fait assassiner 150 marins français qui étaient en visite à Athènes. Heureusement, la diplomatie de Sarrail nous a évité une déclaration de guerre qui aurait été catastrophique. (...)
Cependant, à Paris, les parlementaires en alerte se sont rués contre Briand et Joffre. Briand s’en est bien tiré, comme les politiciens savent le faire : il a modifié son ministère et leur a donné la peau de Joffre.
On a donc sacrifié Joffre, mais on l’a sacrifié hypocritement, comme on fait toujours en République. On a eu des égards pour lui. Il consentait à partir à condition qu’on lui donne un bâton de maréchal. Ce qui fera que, en 1919, c’est lui qui défilera en tête des troupes avec Foch derrière lui !
Mais par qui le remplacer ?
Foch ? Non, pas Foch, parce que Joffre ne veut pas de lui. Il l’a vu à l’œuvre, il se rend compte que c’est un incapable, un activiste dangereux qui ne sait que foncer et ne pense qu’à prendre sa place. En outre, Foch intrigue avec les parlementaires et en particulier avec le plus ignoble de tous, Clemenceau. Dès qu’il a senti le commandement suprême lui échapper, il a écrit à Clemenceau pour lui demander ce qu’il devait faire. Clemenceau lui a répondu : « Non, non, restons tranquilles, tous les deux, on gagnera le pouvoir ensemble. » (...)
Alors Castelnau ? On ne veut pas de Castelnau parce qu’il est trop catholique. Pour cela, la République ne fait pas de cadeau, la France fut-elle dans le plus grand péril ! Alors, on a dit qu’il était malade, qu’il avait des dépressions, et on a fini par l’envoyer au loin, en Russie, je crois.
Alors, qui ? Il reste Pétain.
CRIMINELLE EXCLUSION

Paul Painlevé – le seul, dans ce gouvernement, qui avait de l’intelligence – avait eu maintes fois l’occasion de s’entretenir avec Pétain, car il était chargé de développer le matériel militaire. Les deux hommes ont réalisé ensemble un travail remarquable et ont développé une grande amitié. Painlevé était frappé par le silence de Pétain, ce silence qui rebutait les autres politiciens, mais qui était pour lui le silence d’un homme sage qui réfléchit à tout, qui pense à tout et qui veut sauver la France et ses soldats. (...)
Pétain s’expliqua avec Painlevé sur sa conception de la guerre. Il n’était pas partisan de ces coups de main journaliers ni de ces tentatives de percées que l’on faisait de temps à autre. On ne percerait pas, car les Allemands avaient trop de lignes de repli derrière eux. Il y avait à les laisser venir à l’attaque pour en tuer le plus grand nombre possible et à procéder par offensive sur des objectifs limités, dont l’occupation par nous les contraindrait à évacuer les positions latérales débordées. La guerre ainsi menée serait longue, mais le temps nous fortifierait en matériel d’artillerie et en effectif, car, avec le temps, les Anglais arriveraient toujours en plus grand nombre. On ne parlait pas encore de l’intervention américaine. Quand nous aurions toute notre artillerie et quand le front britannique, en s’étendant, nous aurait permis de constituer de grosses armées de manœuvre en arrière de nos lignes, quand les premières positions ennemies seraient tombées entre nos mains par une série d’opérations limitées chacune à un seul objectif, alors on pourrait, d’accord avec tous nos alliés, passer à une attaque générale décisive. Mais, avant de jouer cette partie suprême, il convenait d’attendre que toutes les chances sur lesquelles nous étions en droit de compter nous fussent acquises.
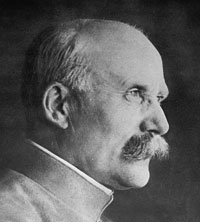 Bien que cette méthode ne différât que par des détails de la méthode de Joffre, Painlevé l’entendant exposer dans une parfaite clarté par un homme qui avait l’expérience de notre guerre et qui, dans les commandements qu’il avait exercés, ne nous avait jamais causé de déception, lui reconnut la valeur de la nouveauté de l’originalité. Pétain fut donc le général en chef de son choix, parce qu’il voyait en lui le meilleur de nos généraux et celui qui promettait de mieux économiser ce précieux capital de la France, la vie de nos soldats.
Bien que cette méthode ne différât que par des détails de la méthode de Joffre, Painlevé l’entendant exposer dans une parfaite clarté par un homme qui avait l’expérience de notre guerre et qui, dans les commandements qu’il avait exercés, ne nous avait jamais causé de déception, lui reconnut la valeur de la nouveauté de l’originalité. Pétain fut donc le général en chef de son choix, parce qu’il voyait en lui le meilleur de nos généraux et celui qui promettait de mieux économiser ce précieux capital de la France, la vie de nos soldats.
Painlevé a donc dit à ses collègues : « Il n’y en a qu’un, c’est Pétain ! » C’était la voix de la vraie France qui parlait en lui.
Mais Briand s’y est opposé, furieux, parce que Painlevé était son ennemi politique. Voilà comment se font les nominations dans les couloirs de la Chambre ou des Ministères...
Le 17 décembre, c’est Nivelle qui fut choisi, tandis que Pétain était mis de côté. Impardonnable favoritisme ! Alors que Pétain avait précisément sauvé Nivelle du désastre devant Vaux et Douaumont, et avait assumé toutes ses erreurs de commandements quand il était son supérieur hiérarchique !
Il ne fit pas de pétition, il n’alla pas chercher de parlementaire pour se faire plaindre. (...)
Pétain évincé, Painlevé obligé de démissionner, l’année 1916 se terminait sous de mauvais auspices.
Nivelle arrivait à Chantilly, fier comme Artaban, disant : « J’ai ma méthode », Et on allait voir ce qu’on allait voir !
Ce qu’on va voir, c’est la gloire héroïque de Pétain qui va se faire gloire tragique, quand il sauvera la France des mutineries.
Abbé Georges de Nantes
Conférence du jeudi 21 avril 1994 (F41)